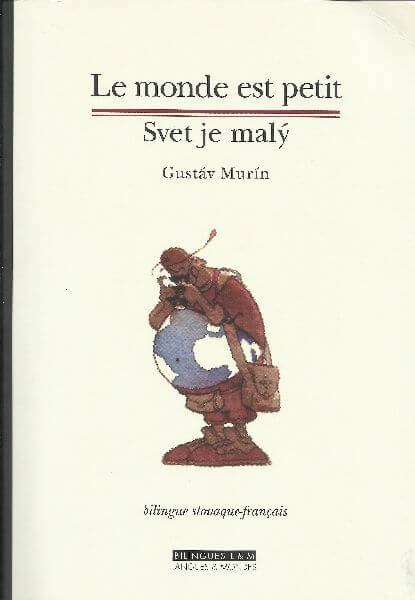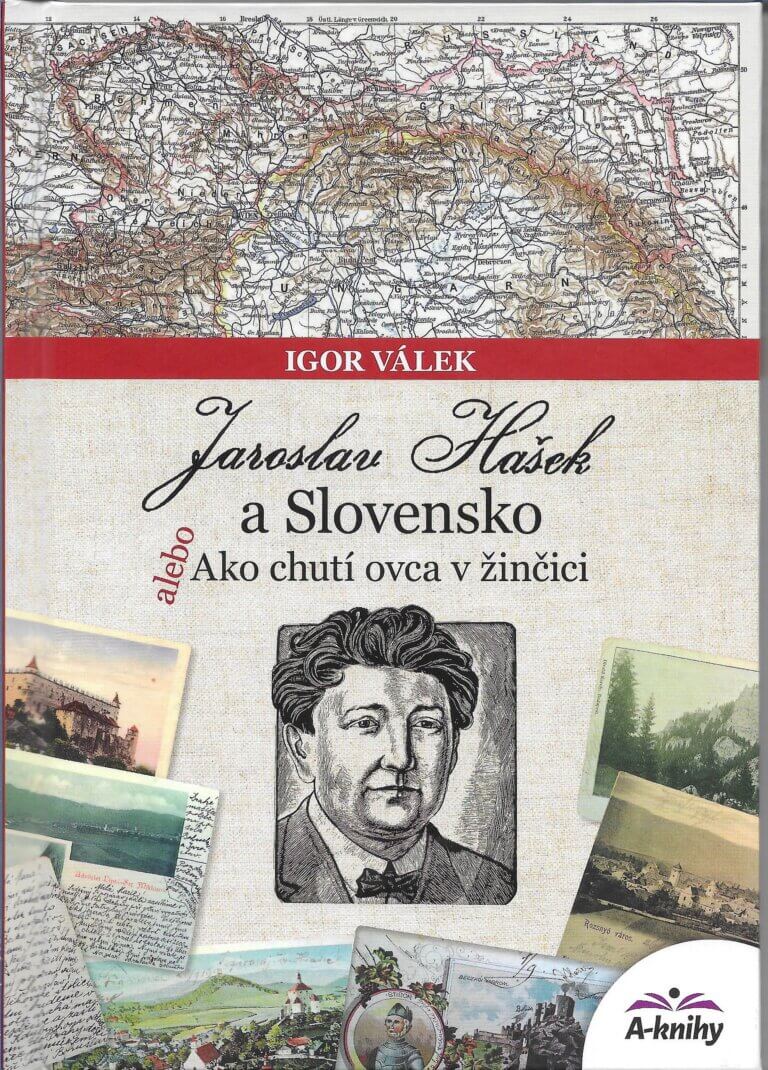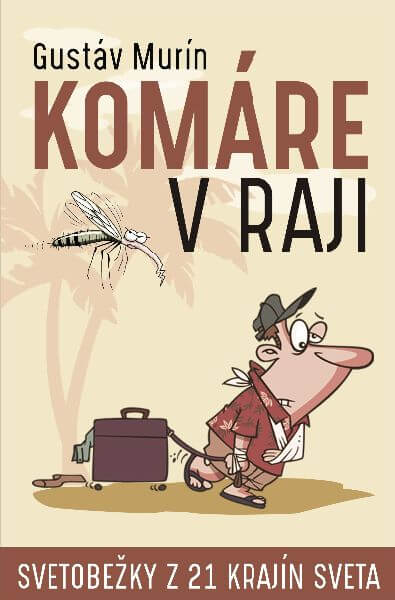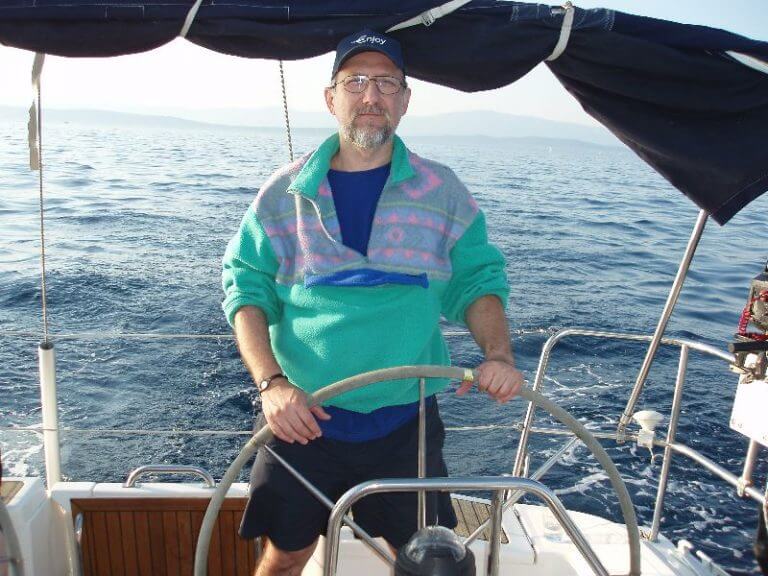Déjà petit garçon j’ai montré que je n’étais pas dépourvu du sens de l’orientation. J’ai guidé mon père quand avec toute la famille nous nous sommes perdus en voiture à Koweït City et à Istanbul. Lycéen je suis parvenu à m’orienter dans la ville roumaine de Constanta où j’ai passé quelques beaux jours avec une jeune fille du nom de Luminica. Quand je l’accompagnais, elle jetait le flou sur notre itinéraire avec tant de soin que je ne savais même pas dans quel quartier de la ville nous nous trouvions et elle finissait à chaque fois par disparaître dans la nuit, car fréquenter des étrangers était, à cette époque, prétexte à une enquête policière. Mais quand un jour je me suis mis dans la tête de la rejoindre, j’ai retrouvé par déduction et de mémoire Luminica et même la maison où elle habitait, alors que je n’y avais jamais été auparavant. Souvent j’ai eu aussi de la chance, comme le jour où j’ai loué une voiture pour la première fois de ma vie et choisi d’aller en excursion aux chutes du Niagara. Je ne devais rentrer à Rochester qu’à la tombée de la nuit. L’idée m’est alors venue d’aller faire un saut jusqu’aux rives du grand lac Ontario. Dès lors j’ai commencé à tourner dans l’obscurité totale par des routes secondaires jusqu’à ce que je retrouve de mémoire l’autoroute qui mène à la ville. Il faut toutefois signaler que je me suis entraîné pendant trois ans à m’orienter en milieu inconnu lorsqu’à huit ans j’ai dû retrouver chaque jour le long chemin de l’école à la maison dans une ville comme Bagdad. C’est pourquoi aucun problème de labyrinthe ne devrait me résister bien longtemps ; la vie m’a d’ailleurs donné la chance d’en résoudre un.
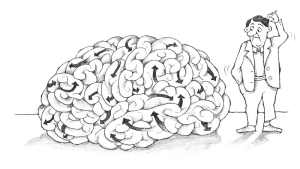
J’ai un ami du nom de Pavol Malovič. Si je lui dis parfois où mes obligations du moment me conduisent n’importe où dans le monde, non seulement il sait aussitôt où se trouve la ville dont je lui parle, mais encore il me conseille d’aller voir une attraction locale. Comme je m’apprêtais à partir pour une conférence scientifique internationale à Lucknow (ville dont beaucoup ne connaissent pas l’existence ; moi-même je l’ignorais ; en fait, c’est en Inde), mon ami Pavol m’a parlé d’une curiosité : un labyrinthe que je ne devrais pas manquer. Heureusement les organisateurs de la conférence étaient aussi de cet avis. Un guide touristique professionnel nous a conduits au labyrinthe de Lucknow. C’était un parfait imbécile. En prélude à notre visite de la ville, il nous a tout de suite annoncé qu’il allait nous prouver que Lucknow était le Paris de l’Orient. A cet effet il nous a traîné par une chaleur suffocante, dans un autobus qui pouvait avoir connu la mobilisation pendant la Première Guerre mondiale, à travers une ville sale et délabrée et nous a montré les sites qui, dans son imagination uniquement, pouvaient rivaliser avec ceux de Paris, y compris les égouts. Ce quadragénaire énergique souffrait de cet aveuglement intéressant que l’on rencontre aussi en Russie, entre autres. C’est l’instinct de conservation des gens qui sont toute leur vie jusqu’au cou dans un cloaque et qui, pour conserver un minimum de dignité humaine (conscients qu’il n’y a pour eux aucune issue possible), se persuadent et persuadent les autres que, si ce cloaque n’apporte rien, au moins il sent bon. Entre parenthèses, notre guide avait au revers de sa veste un petit insigne russe et il est tout à fait possible que le style ampoulé de ses commentaires ait plu justement aux touristes russes. Ils y sont habitués chez eux. Quant à moi il me tapait vraiment sur les nerfs. C’est pourquoi j’ai profité de la première occasion pour échapper à son indésirable sollicitude. Cette occasion ne s’est présentée qu’à l’intérieur du labyrinthe. Le labyrinthe de Lucknow est un édifice vraiment remarquable. Parce que, contre toute attente, il n’est pas souterrain mais forme le premier étage du palais principal qui abrite le mausolée. En outre, il est étonnamment simple, clair, rectiligne. Ses couloirs font le tour de la salle principale du palais et débouchent sur l’intérieur de la salle aussi bien que sur l’extérieur du bâtiment. Les dénivellations des couloirs sont le seul élément déconcertant : vous devez monter quelques marches pour redescendre aussitôt au niveau précédent. J’avais le sentiment que les plaisanteries ennuyeuses du guide au sujet de son prédécesseur qui s’était une fois perdu là dépassaient déjà les limites tolérables de son manque de considération à notre égard. J’ai laissé s’éloigner tout le groupe avec le guide en tête et j’ai vite tourné dans le passage transversal le plus proche. Enfin seul ! Pendant un court moment j’ai ressenti un soulagement triomphant. La voix criarde, amplifiée du guide s’éloignait quelque part derrière le mur. Enfin je pouvais me promener librement, jeter un coup d’œil par les petites fenêtres que je rencontrais de temps en temps, essayer les divers embranchements, penser à mes préoccupations et – me perdre.
Quand j’ai réalisé que j’étais perdu, cela ne m’a nullement inquiété. Je présumais que le labyrinthe était si petit qu’il me suffisait de marcher et que j’arriverais à une sortie. Mais plus je marchais, plus je me persuadais qu’il n’existait aucune autre issue que celle par laquelle nous étions arrivés (et que j’avais complètement perdue sur le plan que j’avais en tête). Il n’existait que les escaliers qui reliaient entre eux les étages du labyrinthe. J’ai monté des marches et, de façon inattendue, je me suis retrouvé sur le toit vide et plat du palais. Une intéressante vue sur le coucher du soleil au-dessus d’un Paris oriental sans attrait s’est offerte à moi. Pourtant une scène banale m’a beaucoup plus intéressé, en bas, dans une cour sale derrière le palais. A l’écart des lieux destinés à l’émerveillement des touristes il y avait là une cabane et des tas d’ordures. Devant la cabane j’ai vu une femme en noir et tout autour des enfants qui couraient sur la décharge. La femme était silencieuse et regardait le jeu des enfants avec cette résignation fataliste que vous rencontrez partout où la pauvreté se trouve trop proche, à un pas infranchissable de la vision d’une vie décente. Les enfants étaient bruyants, joyeux, insouciants comme tous les enfants du monde. Mais leur jeu obéissait à une étrange règle. Bien qu’à première vue impétueux et espiègles jusqu’à l’irresponsabilité, ils ne se déplaçaient jamais, au cours de leurs poursuites insouciantes, que dans la limite d’un cercle aussi invisible qu’infranchissable. Il y avait dans leur indocilité enfantine une discipline terrible qui les empêchait de transgresser les frontières pressenties du possible. Pleins d’énergie, d’espoir, de désirs encore inexplorés, ils s’emberlificotaient dans un dédale de voies sans issues, tout comme moi dans le labyrinthe au-dessus d’eux. Je ressentais cela comme quelque chose d’étrangement proche, presque physiquement intime, comme si j’étais l’un de ces enfants. Le fait que je me tenais nu-pieds, tout comme eux, sur la terrasse au-dessus d’eux, m’y aidait. On ne peut pas pénétrer dans le labyrinthe avec des chaussures. Aussi les avais-je laissées dehors ainsi que mes chaussettes et maintenant, debout dans la poussière jusqu’aux chevilles, je me sentais peu sûr de moi et désagréablement dénudé. De surcroît il me vint à l’esprit qu’avec le soir et la nuit froide qui s’approchaient d’autres groupes de touristes ne passeraient sûrement plus par ici. Et que notre imbécile de guide pourrait facilement m’oublier là, au moins jusqu’au lendemain matin. Nous formions un groupe important de scientifiques de diverses nationalités qui ne se connaissaient pas les uns les autres et, bon gré mal gré, je devais reconnaître que je ne manquerais à personne, au moins d’ici une douzaine d’heures. Une idée m’a envahi l’espace d’un instant et m’a fait froid dans le dos : pour quelque absurde raison, je ne devrais plus jamais sortir de ce labyrinthe de Lucknow autrement qu’en rejoignant en bas cette femme et ces enfants et en restant pour toujours dans leur labyrinthe de misère sans issue. Idée dont j’étais d’autant plus proche que je commençais à peine à savourer le sentiment d’appartenir à un autre monde, un monde d’abondance. Maintenant j’avais la possibilité de voir de véritables pauvres. En bas, au-dessous de moi, une scène banale et cruelle de la vie se déroulait pendant que moi, sur le toit du labyrinthe de Lucknow, j’avais encore une chance de ne vivre qu’une épreuve passagère et peut-être terrible qui, avec le temps et une fois de retour chez moi, se perdrait inéluctablement dans le sac sans fond de ces histoires de voyage toujours joyeuses et qui toujours finissent bien. Je n’arrivais pas à regarder longtemps en bas cette décharge avec ces êtres humains qui, contrairement à moi, n’avaient pas choisi cette aventure de labyrinthe sans issue. J’ai regagné rapidement le labyrinthe par les escaliers, bien décidé à trouver, cette fois-ci, la sortie. Au bout d’un moment des voix insouciantes au milieu desquelles j’ai reconnu aussi, sans le moindre doute, le haut-parleur vagissant de notre guide, sont venues à mon aide. Aussitôt après j’ai aperçu au bout d’un de ces longs couloirs rectilignes notre groupe qui sortait par l’escalier principal devant le palais. Je l’ai rejoint avec grand plaisir…
Traduit par Catherine Hubert
From a book (see in E-book form here) by Gustáv Murín: Le monde est petit – collection of travel stories in bilingual Slovak–French edition, Langues&Mondes–L´Asiathèque Publ., Paris, 2005.