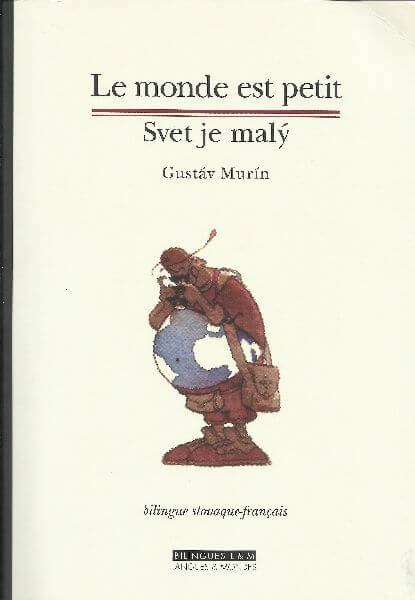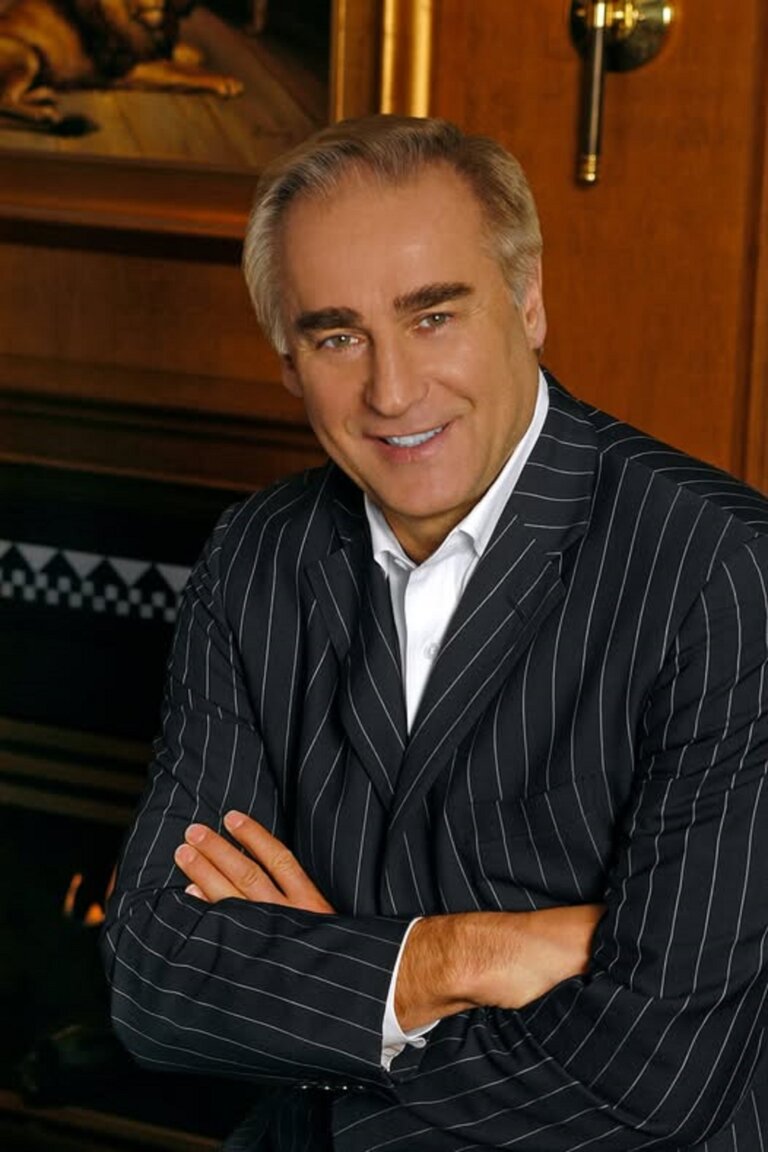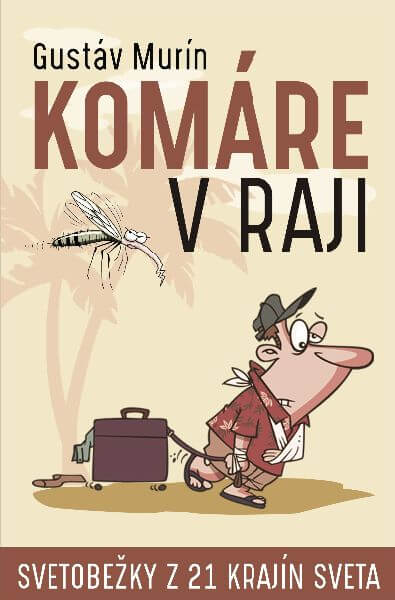Avant mon premier voyage au Mexique, à l’occasion d’un congrès d’écrivain, je ne savais rien de ce pays. Je ne savais même pas qu’un de mes collègues, un scientifique, était déjà là–bas pour un stage d’un an. Quand j’ai enfin pris la décision d’entrer en contact avec lui, la situation semblait sans espoir. Il ne répondait pas à mes messages envoyés par fax. Il s’est avéré plus tard qu’il ne le pouvait pas. Le fax du bureau du laboratoire venait d’être volé. Mon télégramme, dont le coût d’envoi représentait deux mois de budget du laboratoire pour les frais de correspondance, ne lui est jamais arrivé. Les contacts par courrier électronique n’étaient pas possibles et j’ai envoyé une lettre alors qu’il était – d’après toutes mes expériences avec la poste – déjà trop tard.
Or justement cette lettre est arrivée contre toute attente une semaine plus tôt que prévu, un jour avant mon envol. Mon collègue m’a appelé aussitôt et nous avons donc pu nous dire au dernier moment que moi j’arriverais par avion, lui qu’il m’attendrait à l’aéroport de Mexico…et je suis parti.
Mon voyage a été d’autant plus excitant que c’était la première fois que j’allais au Mexique, et aussi que de Mexico je devais me rendre au plus vite à Guadalajara, à des centaines de kilomètres de là. Dans mon voyage vers l’inconnu mon collègue a fait tout ce qu’il fallait en matière de rafraîchissement. Il m’a accueilli à l’aéroport et m’a fait découvrir la bière locale de marque Montejo ainsi qu’une soupe du nom de pozole. Il m’a fait aussi un discours détaillé sur ce que je devais, pouvais et ne pouvais pas faire. Le soir il m’a mis dans l’autocar pour Guadalajara et m’a souhaité bon voyage.
Celui qui a voyagé sur les lignes mexicaines d’autocars de nuit sait qu’il y a là un luxe que l’on ne voit même pas chez nous sur les lignes internationales. J’aurais donc dû me sentir bien et à mon aise mais je ne l’étais pas car je filais de nuit vers un endroit inconnu. A chaque gare de péage, l’autoroute était entourée non seulement de gardes militaires mais aussi de gardes civils étranges en poncho, aussi armés que si nous avions traversé une ligne de front. Jusqu’à Guadalajara je n’ai pas beaucoup dormi.

Vers cinq heures du matin, je suis finalement arrivé à la gare routière de Guadalajara. C’étaient mes douze premières heures sur le sol mexicain et, pour le moment, je n’avais vu du Mexique que l’intérieur d’un autocar aux rideaux tirés. Une autre épreuve m’attendait maintenant: trouver un taxi pour aller à l’hôtel. Et la chose n’est pas simple. Dans de telles situations, un étranger a deux problèmes : ne pas se faire voler son argent quand il paie la course et ne pas se faire voler autre chose pendant la course. Au cours de leur voyage pour le même congrès, des collègues danois s’étaient fait dévaliser à une heure tardive de la nuit en plein centre de Mexico. Un petit taxi vert sous licence d’état les avait conduits dans une ruelle transversale où les compagnons de bouteille du chauffeur les attendaient déjà. Aussi avais–je reçu du collègue qui m’avait accueilli un bon conseil ainsi qu’un avertissement. Le bon conseil était de chercher une station de taxi annonçant « Pre-paid taxi ». Au Mexique – mais aussi ailleurs, par exemple en Inde ou en Malaisie – on a sagement institué la course de taxi payée à l’avance. Vous annoncez votre destination, on encaisse la somme due et on vous donne un reçu, puis un taxi vous emmène où il faut. J’attendais avec une totale résignation la deuxième possibilité, celle de me faire voler sur le siège branlant à l’arrière du taxi. J’étais littéralement couvert de bagages et je repassais dans ma tête, en tentant d’y mettre bon ordre, les deux coups de karaté que j’avais appris. L’un des deux était supposé mortel, mais je les confondais toujours. Avoir peur n’est pas dans mes habitudes, mais se faire des illusions non plus. L’avertissement que m’avait donné mon collègue était qu’il fallait s’attendre au pire si le taxi s’arrêtait de lui-même dans un parc obscur. Et c’est justement ce qui s’est passé.
Les rues de Guadalajara étaient désertes à cette heure matinale et nous roulions depuis longtemps quand le taxi s’est arrêté brusquement au bord d’un parc obscur et que je ne pouvais situer. J’ai regardé rapidement autour de moi pour savoir de quel côté viendrait l’attaque. Mais dans cette rue déserte nous étions seuls. Incrédule, j’ai regardé le chauffeur de taxi. Il ne m’avait ni conduit à l’hôtel, ni volé – que pouvait bien me vouloir ce fou ? Je lui avais donné à notre départ le nom de l’hôtel, « Plazza del Sol ». Le brave homme m’avait bien conduit, mais jusqu’à la place « Plazza del Sol ». Quand il m’a fait le geste international signifiant que nous étions arrivés, il était clair qu’un problème, tout à fait inattendu, se posait encore pour moi. Je n’avais dans toute cette ville de Guadalajara, qui compte plusieurs millions d’habitants, pas d’autre point de repère que ce nom d’hôtel « Plazza del Sol » qui, par un coup du sort, était le même que celui de cette place et de son parc complètement vides. Le chauffeur de taxi ne comprenait pas l’anglais et je ne connaissais pas l’espagnol. Je peux vous assurer qu’on se sent particulièrement seul au monde quand votre chauffeur de taxi ne comprend pas ce que vous lui dites. Il était hors de question de descendre avec tous mes bagages. Je n’avais nulle part où aller et un autre chauffeur de taxi ne m’apporterait rien de mieux. Je ne savais pas quoi faire de plus que de répéter au chauffeur « Plazza del Sol ». A cela il répondait en remuant complaisamment la tête et en me faisant signe de descendre. Aux échecs, on appelle ça être « pat ».
Dans la pénombre matinale, je regardais autour de moi, désabusé. Dans ce pays inconnu et dans une ville inconnue, à des milliers de kilomètres de chez moi, je cherchais quelque chose, un indice, un signe du ciel qui me redonnerait espoir et m’encouragerait à continuer. Et j’en ai trouvé un. Du côté du taxi où j’étais assis, il y avait une longue rangée de petits bâtiments qui formait le plus petit côté de cette place presque carrée. Tous ces bâtiments étaient des boutiques ou des restaurants. Tous étaient fermés et sans lumière. Seul un, précisément celui devant lequel nous nous trouvions, dissipait l’obscurité avec sa grande inscription au néon, juste un mot: SLOVENSKO. Tout d’abord cela me sembla être une hallucination due à mon manque de sommeil. Cette inscription n’avait rien à faire ni ici ni ailleurs, sinon en Slovaquie car elle était vraiment écrite en slovaque. Ce n’était ni l’anglais SLOVAKIA ni l’espagnol ESLOVACA, mais bien le SLOVENSKO de chez nous. Personne d’autre ne pouvait l’avoir écrite qu’un Slovaque qui s’était égaré là, longtemps avant moi. De toute évidence, non seulement il avait survécu mais encore il avait fait inscrire ce message rappelant notre patrie commune. En regardant cette enseigne au néon, j’ai compris qu’ici il était impossible que je me perdre.
Nous avons trouvé peu après l’hôtel « Plazza del Sol » ; il était à l’angle opposé de la place.
Traduit par Matthieu Guinard
From a book (see in E-book form here) by Gustáv Murín: Le monde est petit – collection of travel stories in bilingual Slovak–French edition, Langues&Mondes–L´Asiathèque Publ., Paris, 2005.