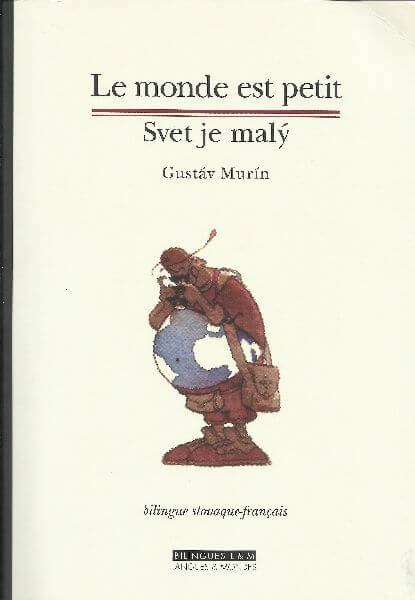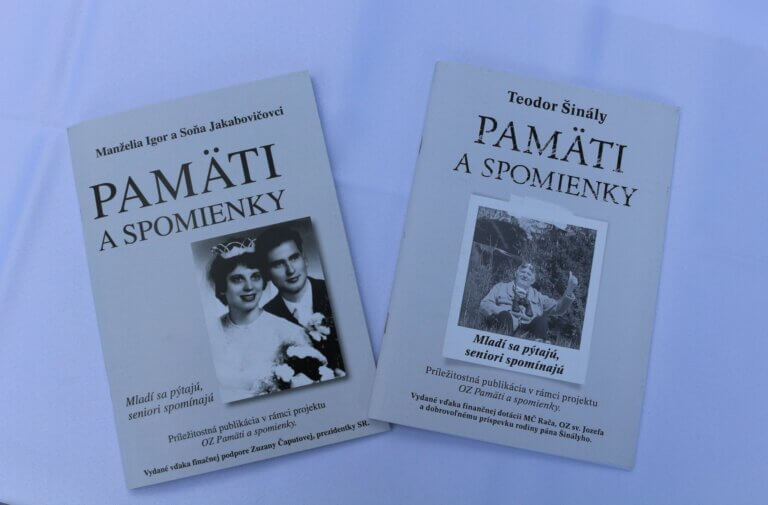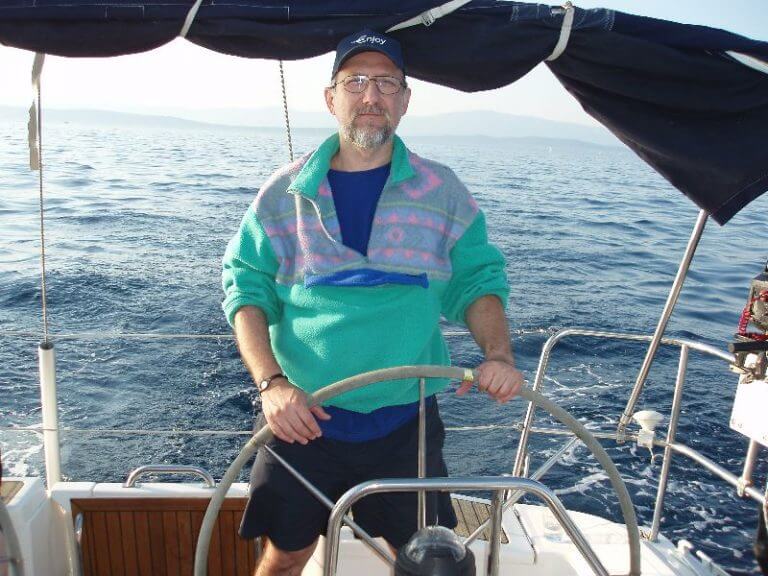Après trois mois de stage de recherche à Séville, mes valises étaient enfin bouclées quand il est apparu que le collègue qui s’était proposé pour me conduire à l’aéroport était malade. Un autre collègue s’est immédiatement proposé. Nous sommes montés en voiture et avons pris la route. Après quelques dizaines de mètres mon collègue espagnol s’est inquiété, a tendu l’oreille, a donné des coups de volant, puis s’est arrêté. Nous sommes descendus de voiture et avons constaté que le pneu arrière droit était à plat. Mon collègue paraissait calme. Il a sorti du coffre l’outillage nécessaire et l’a déballé. Il s’est aperçu alors qu’il lui manquait la clef pour démonter la roue. Les Espagnols sont réputés pour leur grande légèreté dans les choses pratiques et pour croire dur comme fer que tout finit toujours par s’arranger. Dans ce cas précis, une station service est apparue fort à propos non loin de là. Mon collègue espagnol s’y est rendu, a acheté un nouvel assortiment d’outils et a essayé enfin de démonter la roue. Pas moyen. J’ai essayé aussi mais sans succès. Il a réessayé à son tour. Le temps qui passait me contraignait à démonter à tout prix cette maudite roue. J’ai forcé sur la clef et …je l’ai cassée. Mon collègue espagnol a remballé ses outils avec résignation et a regardé autour de lui, décontenancé. J’ai pu à ce moment-là m’assurer qu’en Espagne la civilisation fonctionne, malgré le penchant bien connu des Espagnols à improviser au dernier moment. L’enseigne lumineuse d’un garage brillait à une centaine de mètres derrière nous. Nous avons poussé la voiture jusque là, les mécaniciens l’ont mise aussitôt sur un élévateur hydraulique et ont changé la roue en cinq minutes. Chez nous cela aurait pris cinq minutes aussi mais les palabres avec le mécanicien pour lui faire faire quelque chose en dehors du planning et sans qu’une réservation ait été faite quinze jours à l’avance aurait pris au moins une demi-journée. c’est comme ça qu’à Séville j’ai eu tranquillement mon avion pour Madrid.
A Madrid mes amis m’attendaient. Pepé et sa femme Mercedes, Clara et Ivan, la sœur et le frère de Mercedes, étaient tous venus m’accueillir. Ils savaient que j’étais déjà venu une fois à Madrid quelques jours et ont donc décidé de m’emmener en week-end dans leur maison d’été, dans le petit village de Navaluengo près de Salamanque. C’était un vendredi et mon avion pour Prague s’envolait le dimanche soir. J’ai passé deux jours merveilleux et ensoleillés à Navaluengo. Nous nous sommes bien amusés, bien promenés, et nous avons beaucoup bavardé. J’ai aussi pris conscience que la vie nocturne ne commence ici qu’au moment où chez nous seuls les plus grands fêtards sont encore debout. Donc nous dormions tard dans la matinée. Même le jour de notre départ, le dimanche, tout le monde ne s’est réveillé que vers onze heures. Nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée puis nous sommes allés nous promener. C’est alors que Mercedes m’a demandé, juste pour savoir, l’heure exacte de mon vol.

« Sept heures du soir et il faudrait que je sois à l’aéroport à six heures. »
A l’expression de mes hôtes, j’ai compris à cet instant que ça n’allait pas. Pepé a demandé par acquis de conscience :
« Tu sais qu’on est passé de l’heure d’hiver à l’heure d’été ? Maintenant il est en fait une heure de plus que celle qu’indiquent nos montres ! »
Je savais bien sûr qu’on changeait d’heure. Pour je ne sais quelle raison, j’avais en fait pensé que ce devait être dans la nuit du dimanche au lundi, quand je serais déjà assis paisiblement dans l’avion du retour. Il était une heure de l’après-midi, deux heures en réalité. Iván, qui aurait pu m’emmener plus tôt, était déjà parti le matin et mes hôtes ont donc préparé avec une grande présence d’esprit un emploi du temps improvisé. Par malchance, celui-ci comprenait le déjeuner du dimanche : un bon repas dominical en Espagne ne se néglige pas. Nous sommes donc rentrés à la maison, les femmes ont fait la cuisine, nous avons fait les bagages, avons déjeuné, avons fait la vaisselle, avons rangé, avons fermé la maison et …il était quatre heures de l’après-midi. Pepé, qui conduisait, a déclaré qu’il y arriverait. A peine nous étions-nous mis en route que les jeunes femmes se sont endormies. Mais moi, redoutant la façon dont ça finirait, je ne pouvais pas penser au moindre repos. Pepé me souriait d’un air réconfortant quand nous serpentions par les routes sinueuses de la Sierra de Guadarrama et quand nous devions nous insérer dans une file de voitures qui suivaient au rythme d’un escargot quelque dame au volant qui avait décidé de jouir des beautés du paysage. Malgré cela, tout se serait bien terminé si nous n’avions pas négligé les files d’automobilistes du week-end sur les routes qui mènent à la capitale. Nous sommes restés coincés sans espoir dans l’une d’elle à encore dix kilomètres de Madrid. Les femmes se sont réveillées et ont commencé à se concerter en espagnol avec Pepé. La situation était désespérée. Nous nous trouvions dans une file qui n’avançait qu’au pas. Pas moyen de s’en échapper, de doubler, il n’y avait qu’à se traîner avec les autres. Je savais que c’était mal parti. Et, pour corser le tout, j’avais terriblement besoin de m’isoler ; seulement il n’y avait nulle part où aller. On ne voyait que la plaine aride et dénudée à des kilomètres à la ronde ; pas la moindre petite bosse derrière laquelle aller. Et puis la file de voitures aurait pu, juste à ce moment-là, se mettre en mouvement de façon inattendue ; et courir en tenant mon pantalon jusqu’à la voiture sous les coups de klaxons outrageants…j’ai préféré me retenir. La scène était prête pour une parfaite pièce tragi-comique.
Mercedes et Clara m’ont réconforté. Mercedes en slovaco-russe car elle avait étudié les deux langues. Elle était même allée en Slovaquie avec Pepé et ça leur avait plu. Toute leur bonne volonté ne pouvait rien contre les faits qui se rappelaient sans cesse à moi. Si je manquais mon avion, il n’y avait pas d’autre vol avant quatre jours. Sans parler du fait que j’avais un billet d’avion à date fixe qui donc normalement ne pouvait être changé, et que le mercredi suivant j’avais une autre conférence en Hongrie.
« Calme-toi, Gustáv, si nous n’arrivons pas à temps, nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne t’aurons pas mené jusqu’à Bratislava. »
Mercedes avait beau me remonter le moral, de désespoir, j’ai préféré ramener mon blouson sur ma tête et essayer de dormir. Je pensais qu’au moins ainsi je ne penserais à rien mais ça a été exactement le contraire : les enchaînements d’idées les plus bizarres ont commencé à me venir à l’esprit.
Je ne sais pas si vous croyez aux mystères du voyage mais moi je rencontre régulièrement au cours de mes voyages des phénomènes qui sont, sinon mystérieux, du moins remarquables. Par exemple le voyage aller pour l’Espagne aurait dû déjà me mettre en garde sur ce qui m’attendrait au retour. Le matin où le car de la ligne régulière devait nous conduire à Prague, située à quatre cents kilomètres de là, il y a eu tout d’un coup un tel verglas que les gens ne pouvaient pas faire plus de deux pas sans tomber sur le trottoir. Je n’arrivais pas à dormir, comme avant chaque grand voyage, et j’ai donc vite appelé la collègue qui partait avec moi pour lui dire que nous devions, pour le salut de notre expédition, prendre le train au lieu du car. Le train ne dérape pas. Mais à cause du départ plus tardif du train nous avions très peu de temps pour nous rendre de la gare de Prague au bureau de la compagnie aérienne et pour prendre ensuite le bus pour l’aéroport. Malgré cela, ma compagne de route s’est mise dans la tête qu’à Prague il fallait aller prendre une bière au kiosque. Ce diable de bonne femme a failli me faire avoir une crise cardiaque. Elle avait reçu la même bourse que moi mais elle, c’était pour étudier le flamenco à Madrid. C’était un personnage compliqué mais contrairement à moi elle avait une connaissance parfaite de l’espagnol, la capacité de se préparer ses repas elle-même et l’expérience d’un séjour d’un an à Paris. On aurait pu penser qu’elle comprendrait que c’est dommage de rater son avion à cause d’une bière. Mais elle ne le comprenait pas et ainsi nous sommes arrivés en retard à la station de bus. C’était dimanche ; le bureau de la compagnie aérienne était déjà fermé et le prochain autobus partait pour l’aéroport après le départ de notre avion. Nous étions perdus. Mais avant que je n’aie eu le temps de bien m’énerver est apparu mon ancien ami de Prague à qui j’avais écrit que nous pourrions peut-être nous rencontrer à cet endroit en attendant l’autobus. Comme un ange céleste prévoyant il est arrivé avec le taxi d’un ami et nous a conduit à temps à l’avion qui attendait. Maintenant, en sens inverse, un dimanche encore une fois, j’étais de nouveau pressé sur le trajet de l’aéroport et l’issue dépendait de la même façon du bon vouloir de mes amis. Et pour compléter le tableau, cette fois aussi une bière, celle que j’avais prise en plus du déjeuner, me le rappelait de façon dramatique.
La file de voitures s’ébranla. Dans les collines avant Madrid nous ne semblions grimper de petites côtes que pour voir que derrière il y en avait encore d’autres. Dans ce désert nous nous déplacions au pas sur l’unique route existante et finalement nous sommes arrivés à l’endroit où toute la calamité de la circulation a commencé. Enfin nous avons débouché sur le périphérique. Les maisons et les quartiers autour de nous défilaient très rapidement tandis que Pépé dépassait toutes les vitesses autorisées. Mais toujours pas d’aéroport en vue. En plus, mon besoin de visiter les toilettes atteignait un degré incroyable d’urgente nécessité. Mais arrêtez-vous au milieu du périphérique quand il ne reste qu’une quinzaine de minutes avant le décollage de votre avion ! Et c’est ainsi que des voyageurs ont pu être témoins d’un phénomène inhabituel sur l’aéroport international de Madrid en ce dimanche soir.
A grande vitesse et dans des grincements de freins a surgi une voiture d’où est descendu un jeune homme inconnu qui s’est précipité sans un regard pour ce qui l’entourait dans le hall de l’aéroport. Le chauffeur de la voiture s’est effondré sans bruit derrière son volant, conscient d’avoir rempli son contrat. Puis ce fut le grand numéro des deux jeunes femmes du siège arrière : elles ont sauté de la voiture, ont sorti du coffre les valises de l’inconnu et ont couru avec elles jusqu’à l’enregistrement. Seulement il manquait les papiers.
Je peux vous assurer que les femmes espagnoles ne se laissent pas décontenancer dans les moments critiques. Elles sont entrées dans les toilettes des hommes et m’ont expliqué rapidement la situation. Je leur ai passé mon passeport et mon billet d’avion par-dessous la porte métallique et elles ont disparu. Entre-temps je me suis enfin débarrassé des urgences et tout en me rhabillant j’ai traversé en trombe le hall de l’aéroport. Mercedes et Clara ont juste eu le temps de me tendre mes papiers et la carte d’embarquement, je leur ai fait un signe d’adieu, j’ai passé en courant tous les contrôles et les détecteurs électroniques, de grands clins d’œil des douaniers et des policiers, j’ai trouvé dans ma course la bonne porte de sortie vers mon avion, j’ai couru sur le terrain d’aviation jusqu’à la navette de l’aéroport et j’ai sauté dedans juste avant la fermeture des portes. Cela a coûté plusieurs verres de cognac pour que je reprenne mes esprits, bien calé sur le siège de l’avion, côté fenêtre.
Traduit par Catherine Hubert
From a book (see in E-book form here) by Gustáv Murín: Le monde est petit – collection of travel stories in bilingual Slovak–French edition, Langues&Mondes–L´Asiathèque Publ., Paris, 2005.