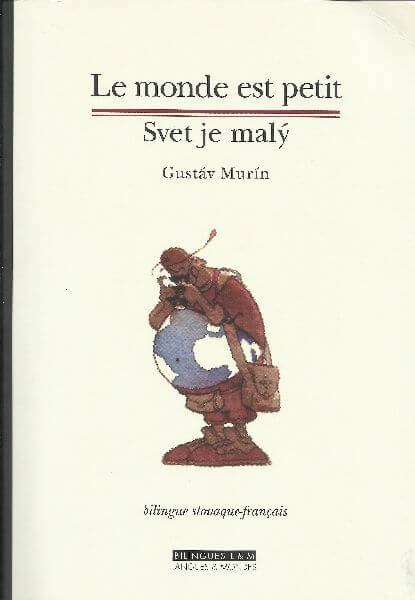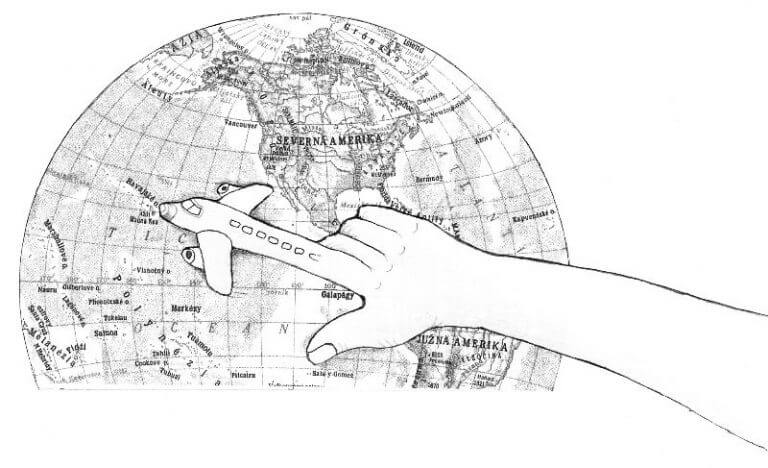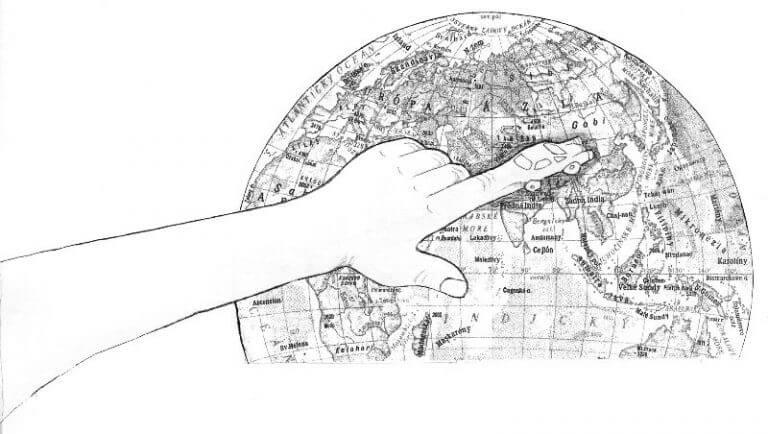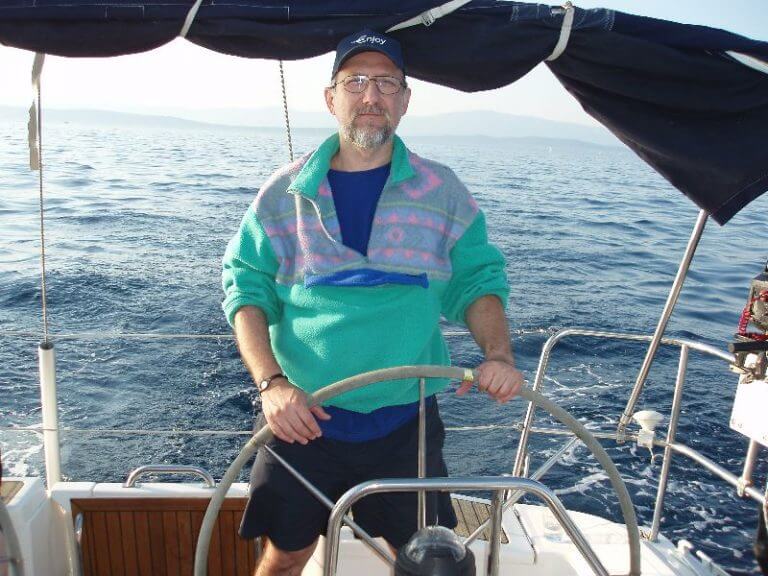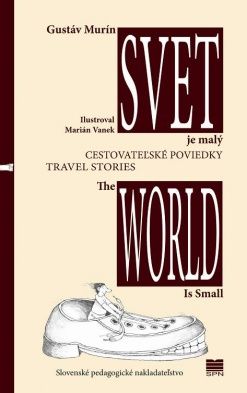A l’Université de Serdang, près de Kuala Lumpur, commençait une conférence. J’étais présent physiquement, mais normalement je n’aurais pas dû y participer. Une malheureuse carte plastique, dénommée carte VISA, en était la cause. Pour les voyageurs de nos jours il est bien confortable de ne pas avoir à emporter des kilos de lingots d’or ou même des liasses volumineuses de billets de banque. C’est justement cette insouciance de personne gâtée par la vie qui méritait d’être punie. La punition est venue à neuf mille cinq cents kilomètres de chez moi, en Malaisie.
Je suis l’heureux propriétaire d’une carte VISA. Elle m’a rendu service partout, au Mexique, en Inde, en Turquie également, mais c’est dans les Pays baltes que j’ai dû voir le plus grand nombre de magasins et de banques qui proposaient leurs services en affichant une étiquette VISA. J’utilisais ce service avec une telle facilité que pour mon voyage en Malaisie non seulement je n’avais pas pris tous les documents qui allaient avec la carte VISA mais je n’avais même pas les numéros de la « hot line » de ma banque. Je croyais tout simplement à la perfection de la technique et elle venait me trahir maintenant, le premier jour d’une conférence mondiale. C’était d’autant plus délicat que je devais intervenir devant le forum international de mes collègues scientifiques justement ce premier jour. Tout le monde pouvait s’installer tranquillement dans la salle, ils avaient tous réglé leur participation à la conférence. J’étais le seul à ne pas pouvoir en faire autant car justement cette fois–ci, par paresse, je n’avais même pas pris avec moi en Malaisie ma réserve de dollars. Tout mon argent tenait ensorcelé dans un petit bout de plastique.

Le premier avertissement est venu à Kuala Lumpur quand j’ai voulu retirer un peu d’argent au distributeur automatique pour faire des achats à Sogo, le supermarché local. J’ai inséré ma carte dans le distributeur et fait mon code secret. Rien, le distributeur m’a rendu la carte. J’ai commencé à m’inquiéter mais je me suis aussi souvenu que ma carte avait été, comme chaque année, renouvelée récemment. J’avais donc aussi un nouveau code secret. J’ai commencé à avoir un terrible doute, est–ce que j’avais marqué quelque part ce nouveau code ? L’espoir reposait sur le bloc–notes que j’ai toujours sur moi. Le nouveau code y était bien marqué. J’ai de nouveau inséré ma carte dans le distributeur, j’ai saisi le nouveau code et ma carte a été rejetée une fois de plus. Cette fois–ci le rejet était accompagné d’un avertissement. Les choses commençaient à devenir sérieuses. A la troisième tentative le distributeur pouvait garder ma carte, et moi je me retrouverais sans rien. J’ai réexaminé les chiffres inscrits sur mon bloc–notes. Mon écriture, qui ressemble plutôt à des traces de griffes, est connue de tous pour son illisibilité et les numéros étaient griffonnés si négligemment que j’aurais pu faire une erreur. Finalement, peu importe le secret, j’ai demandé à mon collègue Karol qui était du voyage de m’aider à déchiffrer ce grimoir. Après une brève discussion nous sommes arrivés à une combinaison de chiffres qui représentait ma dernière chance. Et ça a marché. Ici, à Serdang, qui était un grand campus universitaire, le distributeur ne voulait pas accepter ce nouveau code secret, pourtant vérifié. Plusieurs tentatives hasardeuses n’ont servi à rien. C’était le matin et la queue des Malais et des Malaises derrière moi, avec à la main leurs cartes de crédit qui fonctionnaient certainement, grandissait. Ma collègue malaise du comité d’organisation, qui m’accompagnait gentiment, m’a fermement invité à renoncer. Il était plus que temps, mon intervention commençait dans dix minutes.
Pendant mon intervention, j’ai passé en revue dans ma tête tout ce qui pouvait jouer pour ou contre l’imminente catastrophe. Je n’avais aucune chance de me procurer la somme dont j’avais besoin pour régler ma participation à la conférence (ne parlons même pas de frais de logement et de nourriture) sans ma carte de crédit. Mon collègue Karol ne pouvait pas m’aider car lui il compte uniquement sur de bonnes vieilles liasses de billets dans les chaussettes. Et ses chaussettes n’étaient pas si grandes. Je ne connaissais personne d’autre (c’est le désavantage des grandes rencontres mondiales au parfum exotique), et appeler à la maison pour demander de l’aide n’avait pas de sens. Personne ne pouvait à ma place retirer l’argent du compte qui alimentait la carte VISA, et ma carte de crédit était ici, à Serdang, avec moi. Il ne me restait qu’à persévérer dans mes tentatives.
Après mon intervention, les organisateurs ont fait preuve de patience et ont mis à ma disposition un autre collègue malais, cette fois–ci avec une voiture. Nous nous sommes mis en route. Deux autres distributeurs ont dignement refusé ma carte. Le collègue malais n’a rien perdu de son optimisme et m’a proposé d’aller dans la banque la plus proche. C’est ce que nous avons fait et nous avons donné les explications qui convenaient. Derrière le guichet quelqu’un nous a souri, ils ont pris ma carte VISA et nous ont demandé de patienter un moment. Le moment de patience a été interminable. Le seul thème de conversation possible avec un collègue malais inconnu était le fait que l’on ne peut pas compter sur les cartes de crédit ni sur la technique. Il valait mieux se taire. Notre silence a été interrompu par la venue du responsable de la banque qui m’a rendu la carte avec courtoisie mais en me déclarant très fermement que leur banque ne pouvait rien faire avec et qu’on ne pouvait pas me donner l’argent demandé. J’étais au bord de la panique.
Je ne vous souhaite pas d’éprouver le sentiment qui vous envahit quand le pilier de notre univers mondialisé vous abandonne. Inévitablement vous viennent à l’esprit des idées peu catholiques du genre : Sur quoi peut–on encore compter dans le monde actuel ? Qu’y a–t–il de sûr dans ce monde ?
Le collègue malais avait l’air de vouloir continuer à m’aider malgré notre piteuse visite à la banque. Aurais–je encore une idée quelconque ? Et l’idée est venue. Le distributeur auquel j’avais eu affaire à Kuala Lumpur appartenait à la plus grande banque de Malaisie. C’était ma dernière chance. J’ai demandé s’il n’y avait pas dans les environs une succursale de cette banque. Il y en avait une.
Sur la façade de la succursale de la plus grande banque de Malaisie il y avait un distributeur. J’y suis allé immédiatement et, tel un illusionniste, j’ai exécuté devant mon collègue malais tous les gestes nécessaires pour qu’à la place d’un lapin sorti d’un chapeau l’argent sorte de ce distributeur. Après le bruit habituel de la machine réfléchissant à haute voix, le signal avertisseur, déjà bien familier ce jour–là, a retenti et le distributeur m’a rendu la carte. Je suis entré dans la succursale, animé par un sentiment d’urgence vitale. J’étais désespérément décidé de faire n’importe quoi pour avoir mon argent, y compris provoquer un scandale international. Si je n’agissais pas ainsi, je ne serais plus qu’un tricheur, un suspect sans un rond dans les poches et non plus un collègue honorable disposant d’un compte en banque respectable.
Je n’étais plus en état de faire la queue, j’ai demandé tout de suite à mon collègue malais de m’annoncer chez le responsable de la succursale. Peu de temps après nous étions assis dans son bureau. Il était grand, gros, flegmatique, tout en sueur, mais aimable. Il a écouté toute l’histoire, a pris délicatement ma carte VISA entre ses doigts, l’a regardée attentivement, a recherché son numéro dans l’ordinateur et a envoyé l’information obtenue quelque part. Il n’a pas été satisfait du résultat. Je me suis mis à transpirer ce qui ne pose en Malaisie aucun problème. Sauf que moi, je transpirais deux fois plus.
Le responsable de la succursale a gardé son calme. Il a regardé encore une fois toutes les données sur ma carte, m’a demandé mon passeport et le nom de la banque qui avait émis la carte (ce qui n’a pas aidé car son nom slovaque n’a aucune chance de faire bon effet dans une conversation internationale) et a décroché le téléphone. Il appelait la centrale à Kuala Lumpur.
Pendant tout ce temps mon collègue malais, assis à côté de moi, essayait de me garder au–dessus du niveau de désespoir par des regards encourageants. De temps en temps le chef de la succursale et lui échangeaient quelques mots en malais ; cela pouvait être soit pour commenter les choses en ma faveur, soit pour se demander s’il n’était pas temps de démasquer un fraudeur international. J’étais seul au milieu d’un pays inconnu et le petit morceau de plastique, seul lien plastique que j’avais avec ma patrie et mon compte, se dissolvait petit à petit. La liaison téléphonique avec la centrale à Kuala Lumpur n’était pas fiable. La ligne était interrompue sans arrêt. L’atmosphère dans la succursale de Serdang était calme, provinciale. Personne ne se pressait nulle part, et moi je pouvais même nager dans ma sueur. Je me suis triomphalement rappelé que je gardais toujours les tickets des distributeurs. J’ai fouillé toutes mes poches et j’ai trouvé finalement celui du supermarché de Sogo. Plein d’une énergie renouvelée, j’ai fait un geste victorieux et je l’ai tendu avec enthousiasme au chef de la succursale. Il a regardé poliment le petit bout de papier tout froissé et plein de sueur et me l’a rendu. Ça ne l’avait pas impressionné vraiment. Il continuait à téléphoner.
La ligne téléphonique s’était interrompue pour la deuxième fois et le chef de la succursale de Serdang dictait pour la troisième fois les multiples données de ma petite carte plastique quand il a haussé brusquement les sourcils. L’espoir naissait. Mais il reposait sur une chose, ou plutôt une question :
« Comment s’appelle votre mère ? » a demandé le chef de la succursale de Serdang en se penchant vers moi comme pour une confidence.
« Qui ?! », je ne comprenais pas.
« Le nom de jeune fille de votre mère ? »
« Mais ma mère n’a jamais eu de compte VISA, ni maintenant ni avant de s’être mariée. »
« Mais vous l’avez mentionnée dans le questionnaire de votre carte VISA, non ? »
Bien que je déteste les questionnaires, à ce moment–là j’ai eu un soupir de bonheur et j’ai entrepris avec plaisir de dicter le nom de ma mère.
Le chef de la succursale de Serdang m’a même laissé l’écrire sur un bout de papier. Et rien n’était plus curieux que d’entendre prononcer en malais le nom de jeune fille de ma mère, qui n’est pas courant chez nous non plus. Ça a marché.
J’ai reçu mon argent, j’ai poussé un soupir de bonheur et j’ai secoué cordialement la main du chef de la succursale de Serdang ainsi que celle de mon collègue malais. Je n’ai compris qu’une fois dehors, dans la rue brûlante. J’ai compris que même si personne d’autre ne le sait, du moins les banquiers du monde entier, eux, savent que tout peut être incertain dans ce monde sauf une mère. Une mère, on peut toujours compter dessus.
Traduit par Diana Lemay
From a book (see in E-book form here) by Gustáv Murín: Le monde est petit – collection of travel stories in bilingual Slovak–French edition, Langues&Mondes–L´Asiathèque Publ., Paris, 2005.