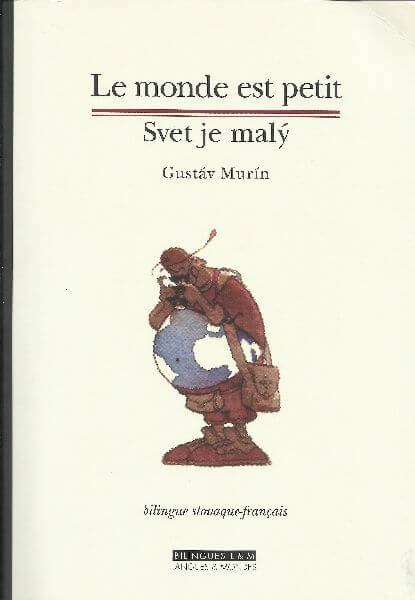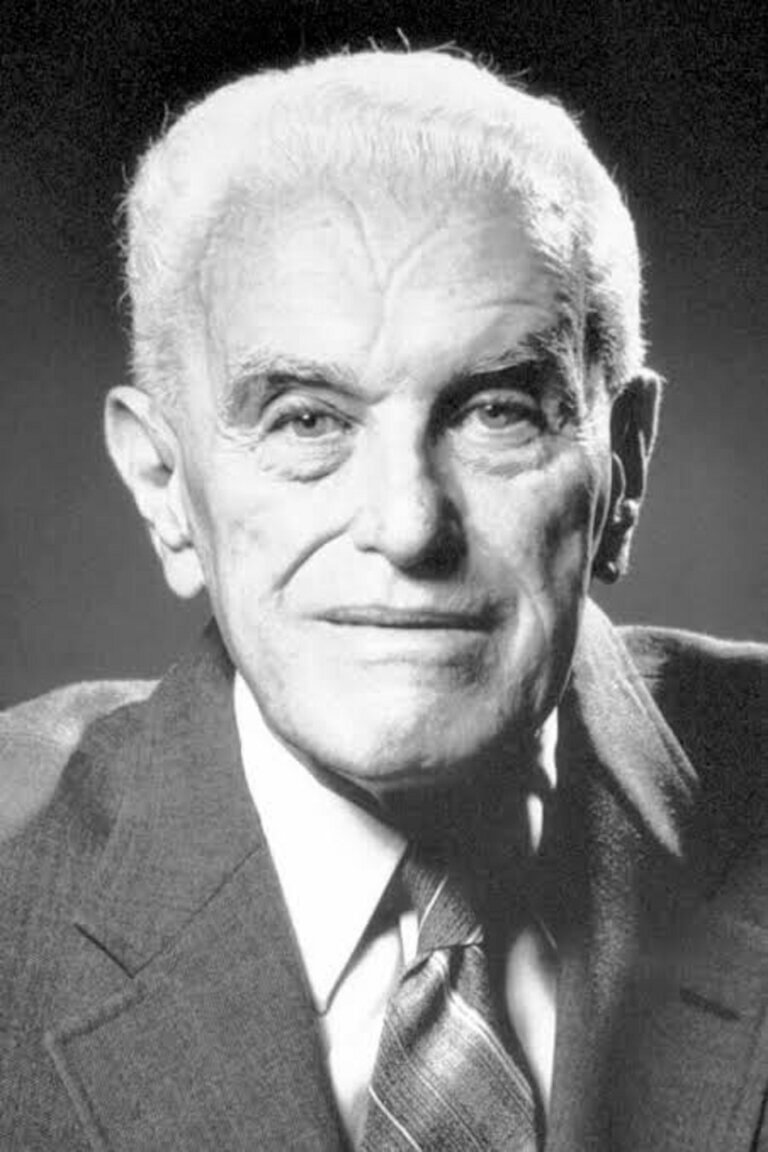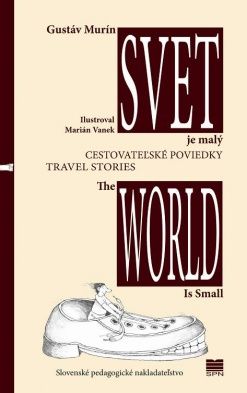Cette histoire sur les chaussures qui m’ont rendu de bons et loyaux services pendant douze ans, si j’étais Elvis Presley je vous la chanterais. J’aimais les miennes au moins aussi fort qu’Elvis les siennes dans sa chanson « Blue Suede Shœs ». Mes chaussures étaient gris argent, souples, fines, confortables, elles montaient jusqu’aux chevilles. Je les ai achetées auprès d’une coopérative de cordonniers invalides, dans la ville de garnison où je faisais mon service militaire, juste avant de retourner à la vie civile après l’année de service obligatoire. Elles étaient étonnamment bon marché, mais c’était du travail de bonne qualité, fait main – et c’est de cela qu’il s’agit dans cette histoire.
Il est terrible de voyager à travers un pays sortant à peine du Moyen Âge, comme par exemple l’Inde. Mais il est plus terrible encore de voyager à travers un pays qui est retourné au Moyen Âge à la suite de guerres fratricides, ce qui est le cas de la Géorgie. Un pays qui même dans la misère du régime communiste avait su rester une oasis d’abondance, voire de surabondance, et que notre expédition d’écrivains a trouvé dans un état d’apathie et de déliquescence totales. Tout le pays semblait paralysé. Imaginez par exemple qu’un camion passe devant vous : sur le réservoir de fioul il y a une telle couche de terre que des touffes d’herbes y poussent déjà. Les vitres du car qui transportait notre groupe d’écrivains étaient perforées par des balles. Dans ce pays, on ne remplaçait pas les vitres fêlées ou transpercées des voitures (et on en voyait tout le temps) car on n’avait pas de quoi. Cette conférence littéraire a été l’une des aventures les plus sauvages que j’ai jamais vécues à l’occasion de ce type d’événements. Durant la conférence nous avons acquis petit à petit la certitude que nos jeunes collègues, les organisateurs géorgiens, refusaient tout appui officiel de l’État (alors que l’un d’entre eux avait été ministre de la Culture du précédent gouvernement !). Ils comptaient surtout sur l’aide financière de leurs amis. Mais leur solide cercle d’amis purement géorgien était constitué en majeure partie d’acteurs de ce qu’on appelle en termes choisis le marché noir, voire l’économie grise. Leur soutien à la littérature fut remarquable mais aussi en termes choisis « particulier ». Chaque jour une voiture différente venait – toujours d’une marque étrangère de luxe – et ses occupants nous livraient une caisse de whisky et des cartons de cigarettes Marlboro. Ils supposaient, évidemment, que c’était le combustible essentiel de nos activités et discussions littéraires. C’était une sorte de manifestation semi privée et je devais admettre que la Géorgie était probablement le seul État au monde où la littérature jouissait d’une telle importance même pour la mafia locale. Dans un tel environnement on peut bien imaginer que le programme de notre conférence ait été imprévisible. Il arrivait que nos organisateurs géorgiens nous quittent tout bonnement et que nous restions dans l’incertitude de ce qui allait se produire, suivant tant bien que mal le rythme de notre programme de travail. Ainsi le troisième jour de la conférence nous nous sommes retrouvés en excursion au diable vauvert. Il y avait des routes effrayantes menant Dieu sait où à travers les montagnes escarpées et coupées de barrages gardés par des miliciens armés et ignorés de notre chauffeur. Il n’a fait halte que lorsque je lui ai demandé à quoi servaient ces barrages. Des miliciens armés de mitraillettes nous ont expliqué que les barrières délimitaient les tronçons de la route qui étaient sous le contrôle de la guérilla locale (nous ne savions pas qu’il y eût la moindre insurrection en Géorgie!) et qu’en plein jour cette dernière n’allait pas nous déranger. L’attitude de notre chauffeur nous laissait à penser qu’il connaissait par leur nom les rebelles qui éventuellement auraient pu nous arrêter. Nous contournions donc les obstacles et nous nous frayions un chemin sur des routes où on ne pouvait avancer en ligne droite plus d’une cinquantaine de mètres à cause des trous dont l’abondance dépassait celle des boutons d’une varicelle bien développée. Notre course éreintante s’est terminée brusquement et sans avertissement, dans une petite ville. Là, les organisateurs nous ont tout simplement fait descendre de voiture et sont partis régler leurs affaires.
Un étranger qui attend en plein jour sur une place d’une ville inconnue ne peut avoir recours qu’à une seule occupation pour calmer ses nerfs – prendre des photos. Nous avons donc sorti nos petits appareils photo automatiques, et croyant passer notre temps d’une manière utile, nous prenions des photos. Une petite hutte délabrée a attiré notre attention, c’était une espèce de tente en bois portant une inscription « Remont obuvi» (Veut dire « Réparation de chaussures » en russe). C’était un tout petit atelier de réparation de chaussures. Ce qui n’aurait eu rien de particulièrement intéressant s’il n’y avait eu à la porte de cet atelier une petite fille et un chiot.
Tous deux étaient barbouillés et curieux, comme seuls les enfants et animaux savent l’être. Ils nous observaient prudemment de la porte. Un cliché ravissant en toute circonstance. Chacun de nous a pris quelques photos, quand tout à coup une voix s’est fait entendre, parlant russe avec un accent géorgien :
« Où il est ce Slovaque?!»
Cette question fait partie des mystères que j’ai rencontrés et qui resteront pour moi inexpliqués jusqu’à la fin de mes jours. Pourquoi parmi nous tous cet inconnu m’avait-il précisément choisi, moi, et comment avait-il pu savoir que j’étais slovaque? C’était en effet un vrai mystère. Espérant découvrir une explication peu ordinaire, je me suis présenté avec empressement.
L’homme était du genre de ces types qu’on peut rencontrer en Géorgie comme en Inde ou au Mexique. Ils passent leur vie à piétiner sur place, ou assis en groupes dans les rues des villes et des villages, ils discutent, sirotent du thé et observent très attentivement les moindres mouvements qui entrent dans leur champ visuel. Le mieux serait de les saluer poliment à chaque fois qu’on passe dans « leur » rue. A première vue ils n’ont pas l’air effrayants mais ce sont eux qui constituent la garde de « l’opinion publique » de ces communautés de rue. Ils vous jugent aussitôt et, si vous ne leur plaisez pas, le mieux à faire c’est de vous éloigner le plus vite possible. Le pire qui puisse vous arriver, c’est d’avoir besoin de recourir à leurs services ou de dépendre d’eux de n’importe quelle façon. Ils sont issus de cette couche de population des pays défavorisés qui constitue la base de l’État. Je suppose qu’ils ne produisent pas grand chose, mais il est très utile d’être bien avec eux. Et c’est pour cette raison que notre entretien avec l’inconnu (hirsute, mal rasé et aux vêtements élimés) a commencé de la pire façon possible. L’homme s’est approché très près de moi, m’a regardé droit dans les yeux et m’a demandé d’un ton provocant, en élevant la voix:
« Pourquoi prends-tu en photo un estropié? »
J’ai compris que ça allait mal. Dans la cabane portant l’inscription « Remont obuvi » devait se trouver un estropié. Ce qui est assez courant dans ce métier. Je ne l’ai pas vu, je ne le savais pas, mais ce n’était pas une excuse. L’inconnu était convaincu qu’il était tout à fait dans son droit en donnant une leçon à un étranger et il savait aussi bien que moi qu’il pouvait compter sur la solidarité de ses compagnons de rue. Les estropiés et les enfants sont sacro-saints dans tous les pays. Malheur à tout étranger qui fait un faux pas dans ce domaine. Moi, je l’ai fait, même si c’était sans le savoir.
Comme cela arrive dans des moments pareils, ceux qui auraient pu m’aider se tenaient autour en silence et observaient quelle suite prendrait ce spectacle inattendu. Les compagnons de l’inconnu commençaient à resserrer lentement le cercle autour de nous et à prêter l’oreille. Chaque mot avait son importance et je savais bien que je pouvais parler de n’importe quoi sauf de l’estropié. Cela aurait donné à l’homme l’occasion de donner une leçon déjà toute prête à un étranger arrogant, hautain et insensible.
« Vous savez, cher ami », ai–je commencé avec prudence. Dans un effort désespéré pour inventer quelque chose, j’ai jeté un regard pensif à mes chaussures, mes chaussures en daim tant aimées, et la réponse salvatrice a vu le jour. « J’ai pris en photo votre « Remont obuvi », parce que chez nous il n’y a plus d’ateliers de réparation de chaussures. »
« Vous le dites sérieusement? » l’homme m’a regardé avec surprise mais aussi d’un air soupçonneux. Il sentait que je l’entraînais sur un terrain inconnu et il ne renonçait pas facilement à quitter le sien.
« Absolument! Vous rendez–vous compte, chez nous on fabrique des chaussures de si mauvaise qualité que ça ne vaut même pas la peine de les faire réparer. Rien que de la matière plastique. Nous sommes obligés de les jeter directement. »
« Ça alors?! » s’étonna l’homme tout content. Il est toujours bon d’apprendre aux représentants de l’opinion locale quelque chose qui leur donne un sentiment de supériorité. Dans ce cas ils aiment prendre un ton d’hôtes condescendants. « Vous êtes donc tombés bien bas.. .»
« Eh, bien, c’est vrai, » me suis–je empressé d’approuver.
« Où va ce monde, » l’homme a décidé d’entretenir la conversation mais, comme s’il regrettait de renoncer à l’éventuelle dispute entrevue, il a repris pour un instant son ton de bienveillance dédaigneuse. « Eh bien, si tu fais la photo d’un cabanon comme ça, pourquoi ne fais-tu pas une photo de quelque chose de vraiment beau?! »
L’homme a montré d’un large geste la place, où il n’y avait vraiment rien de beau. Ayant jeté à cette occasion un regard circulaire, je me suis rendu compte que le cercle de curieux qui s’ennuyaient commençait à se disperser. C’était gagné, il suffisait de continuer à caresser mon interlocuteur dans le sens du poil.
« J’économise la pellicule pour vos magnifiques montagnes. »
« Ah, oui, » a approuvé l’homme, satisfait, « nos magnifiques montagnes. » Il a regardé attentivement les crêtes éloignées, comme s’il voulait vérifier que les montagnes étaient aussi belles que d’habitude, puis il a ajouté tout simplement : « J’habite non loin d’ici, viens prendre une vodka… »
De retour en Slovaquie, j’ai raconté cette histoire à ma femme, avec le pathos héroïque qui succède toujours à une grande peur suivie d’une fin heureuse. Plutôt que par mon histoire, drôle après coup, elle était captivée par l’état de mes chaussures en daim.
« Tu portes ces chaussures impossibles depuis une éternité. Tu devrais en acheter de nouvelles ! »
J’étais juste en train de me déchausser; j’ai donc pris avec indignation les chaussures dans mes mains.
« Nouvelles chaussures ?! Pour remplacer celles-ci, qui sont inusables et représentent les derniers spécimens d’un travail de qualité fait à la main ?! »
Je lui ai mis les chaussures sous le nez comme preuve. Elle a hoché la tête comme si elle n’avait rien à apprendre et, avant de me laisser à ma naïveté, elle a ajouté : « Regarde donc mieux tes chaussures inusables. »
J’ai jeté un regard sur mes chaussures inusables et j’ai eu l’impression d’être au bord de l’infarctus. Les semelles étaient fendues d’un bout à l’autre. Elles devaient être déjà dans cet état au moment où j’avais eu la prise de bec avec l’inconnu devant le cabanon géorgien « Remont obuvi ». Mais je n’ai pas laissé tomber.
Dans un atelier de réparation de chaussures de notre quartier ils m’ont mis carrément à la porte.
« Nous ne faisons plus de réparations de ce genre depuis bien longtemps. Nous ne réparons que ce qu’on peut recoller ou recoudre. Essayez en ville. »
J’ai essayé en ville. J’ai fait le tour de plusieurs ateliers de réparation, sans succès. Dans le dernier ils ont été particulièrement patients avec moi. La femme au comptoir est partie avec mes chaussures quelque part derrière et est revenue avec elles et un vieux cordonnier en plus. Le cordonnier a pris les chaussures entre ses mains, en connaisseur, il a rompu complètement les semelles cassées et a hoché tristement la tête.
« Il faudrait arracher les semelles et en mettre de nouvelles. Mais nous ne savons plus le faire. Il y a une vingtaine d’années, on nous a ordonné de brûler nos bonnes vieilles formes. Selon le plan quinquennal nous devions produire une telle quantité de chaussures dans notre pays que leur réparation n’aurait plus valu la peine. »
Je me souvenais aussi de ces projets futuristes, mais de nos jours on a de nouveau le capitalisme, n’est–il pas vrai?
« De belles chaussures, » il me les a rendues avec regret, « on n’en produit plus de comme ça chez nous. Et plus personne ne vous les réparera dans ce pays. Peut-être encore… »
« Je sais », dis–je, car soudain une pensée fataliste m’est venue, « je connais un endroit où on pourrait encore les réparer. »
Je suis rentré chez moi et j’ai déposé mes chaussures en daim tant aimées sur l’étagère. Car, qui sait? un jour, si je me rends encore en Géorgie…
Traduction de Mária Michalková revue par Catherine Hubert
From a book (see in E-book form here) by Gustáv Murín: Le monde est petit – collection of travel stories in bilingual Slovak–French edition, Langues&Mondes–L´Asiathèque Publ., Paris, 2005.